Página inicial > Sophia Perennis > Nikolai Alexandrovich Berdyaev > Berdyaeff: LA DIALECTIQUE DU DIVIN ET DE L’HUMAIN D’APRÈS LA PENSÉE ALLEMANDE.
 Berdyaeff: LA DIALECTIQUE DU DIVIN ET DE L’HUMAIN D’APRÈS LA PENSÉE ALLEMANDE.
Berdyaeff: LA DIALECTIQUE DU DIVIN ET DE L’HUMAIN D’APRÈS LA PENSÉE ALLEMANDE.
domingo 6 de abril de 2008, por
Le troisième acte du drame commence par Feuerbach qui fut un penseur remarquable [12]. D’après Feuerbach, l’homme a créé un Dieu à son image et ressemblance, en aliénant dans une sphère transcendante sa propre nature. La nature ainsi aliénée doit être rendue à l’homme. La croyance en Dieu est un produit de la faiblesse et de la misère de l’homme. Un homme fort et riche n’a pas besoin d’un Dieu. Le mystère de la religion est un mystère anthropologique. L’idée de Dieu doit ainsi céder la place à l’idée de l’homme, et la théologie à l’anthropologie. D’après Hegel, Dieu parviendrait à la conscience-de-soi dans l’homme. D’après Feuerbach, la conscience-de-soi de l’homme suffit, puisque la conscience-de-soi de Dieu n’est que celle de l’homme, la conscience qu’a l’homme de sa propre nature divine. Homme ou Dieu, il ne s’agit que d’une seule et même nature. Le divin absolu est remplacé par l’humain absolu. Feuerbach proclame la religion de l’humanité. Le matérialiste Feuerbach a écrit son livre sur l’essence du christianisme dans le style des livres mystiques. Il est lui-même par sa nature profondément religieux. Mais par la divinisation de l’humain il entend la divinisation de l’espèce, de la société, et non celle de l’individu, de la personne. Sous ce rapport, sa philosophie reste, tout comme celle de Hegel, une philosophie du général, de l’universel; elle n’a rien de personnaliste. Sa philosophie est un pont qui relie la philosophie de Marx à celle de Hegel; elle constitue, en ce qui concerne les rapports entre le divin et l’humain, un moment dialectique important de la pensée allemande; elle reste, par sa tendance, moniste, et ignore la double réalisation de l’humain dans le divin et du divin dans l’humain. Si Hegel rend à Dieu ce qui appartient à l’homme, Feuerbach rend à l’homme ce qui appartient à Dieu. L’un et l’autre ont fait subir un déplacement au divin et à l’humain. Le passage de Hegel à Feuerbach n’était d’ailleurs ’pas bien difficile. Déjà Khomiakov prévoyait que la philosophie de Hegel aboutira au matérialisme. Feuerbach est, pour ainsi dire, un enfant de Hegel, comme le sera plus tard Marx. Tel fut l’aboutissement de cette géniale dialectique.
Le pas suivant fut fait par Max Stirner et, finalement, par Marx dans une direction, par Nietzsche dans une autre. Max Stirner veut être plus conséquent que Feuerbach. Il nie la réalité de l’homme, de la société, de toute communauté et ne reconnaît comme seule réalité que le Moi, l’Unique, dont le monde entier est la propriété. Son livre : L’Unique et sa propriété, rappelle également de temps à autre les vieux livres mystiques allemands, tout comme l’Essence du christianisme de Feuerbach. On pourrait croire que Max Stirner est un extrême individualiste, qu’il attribue la plus haute valeur à l’individu, à l’unique. Pas le moins du monde, car il est en réalité aussi antipersonnaliste que Hegel. Il n’est pas difficile de se rendre compte que l’Unique de Stirner n’est pas l’homme-unique, la personne humaine, mais le pseudonyme du divin. La première impression qui se dégage de son livre est que Stirner est aussi matérialiste que Feuerbach, mais en l’examinant de plus près on s’aperçoit que son Unique porte un caractère presque mystique et on y perçoit des résonances de la vieille mystique allemande qui a servi de point de départ à tout le processus dialectique de la pensée. L’Unique de Stirner est l’Universel; pas même le microcosme, mais le macrocosme. Dans le désir de voir l’homme en possession de l’Univers entier, il y a quelque chose de légitime, mais la philosophie de Stirner se révèle incapable de justifier ce désir. Chez Karl Marx, qui a suivi une autre direction, le divin-universel revêtira la forme du collectif social, d’une société parfaite à venir, mais d’une société dans laquelle la personne humaine sera noyée, comme elle l’est dans l’Esprit de Hegel et dans l’Unique de Stirner. Marx a puisé sa philosophie à des sources humanistes [13]. Il dénonçait le capitalisme, en l’accusant d’aliéner la nature humaine, de déshumaniser l’homme, de transformer l’ouvrier en une chose (Verdinglichung), et il voulait rendre aux ouvriers leur nature aliénée. Cette remarquable idée représentait l’extension à la sphère sociale de l’idée de Hegel et de Feuerbach sur l’aliénation. C’est ce que j’appelle objectivation. Mais la philosophie de Marx, à son tour, se heurte à l’une des limites de l’humanisme, limite au delà de laquelle il se transforme en l’antihumanisme. Cette transformation tient à des causes métaphysiques profondes. Après avoir déclaré que c’est l’humain qui est l’unique et qui possède la valeur la plus haute, ce qui implique la négation du divin, on finit par aboutir insensiblement à la négation de l’humain lui-même et à sa subordination eau "général, que ce soit l’Unique de Stirner ou le collectif social de Marx. C’est toujours l’antipersonnalisme qui triomphe. C’est ce qu’on voit sous une autre forme, mais avec beaucoup plus d’acuité et exprimé d’une façon plus géniale, chez Nietzsche et dans sa tragique destinée. Nietzsche mérite une attention toute particulière. Mais avant d’aborder la philosophie de Nietzsche, je ferai remarquer que Kierkegaard qui, sans être Allemand, n’en a pas moins été nourri de la pensée allemande et du romantisme allemand, répugnait également à affirmer l’existence de deux natures : la divine et l’humaine et semble pencher plutôt vers la négation de l’humanité, de la nature humaine du Christ.
[12] Le principal ouvrage de Feuerbach : Das Wesen de Christentums est tombé dans un oubli immérité. C’est un des livres les plus remarquables parus au XIXe siècle.
[13] Le Nachlass (œuvres posthumes) de Marx présente sous ce rapport un intérêt particulier. Voir plus spécialement l’article : « Philosophie und Nationalökonomie ».
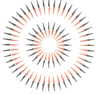 PhiloSophia
PhiloSophia
