Página inicial > Antiguidade > Brochard : LES MYTHES DANS LA PHILOSOPHIE DE PLATON
 Brochard : LES MYTHES DANS LA PHILOSOPHIE DE PLATON
Brochard : LES MYTHES DANS LA PHILOSOPHIE DE PLATON
segunda-feira 17 de junho de 2013, por
Il faut remarquer, en effet, que, si Platon a le premier peut-être nettement défini la science et l’a distinguée de tout autre mode d’affirmation, il fait aussi, dans son système, une part très large à l’opinion, doxa. C’est ce qu’on voit avec la dernière précision à la fin du Ve livre do la République, où l’opinion est représentée comme intermédiaire entre la science et l’ignorance, de même que le devenir est l’intermédiaire entre l’être et le non-être. On le voit non moins clairement dans la page si souvent citée de la fin du VIe livre de la République. Dans l’opinion, il distingue deux degrés : l’opinion vraie, doxa alethes, orthe doxa, et la fausse. Or il se trouve que l’opinion vraie a une grande valeur à ses yeux, et que, si jamais il ne la confond avec la science, du moins elle ne lui en paraît pas très éloignée. Il indique nettement dans le Banquet (202, A) en quoi l’opinion vraie diffère de la science, et la même distinction se trouve dans le Timée (51, D). Mais cette distinction faite, il considère l’opinion vraie comme très proche de la science. Elle en est l’équivalent toutes les fois que nous ne pouvons pas atteindre à la vraie science démonstrative. L’opinion vraie est bans doute, en un sens, toujours inférieure à la science, puisqu’elle est privée de la raison, et ressemble à ces statues de Dédale qui s’enfuient sans qu’on puisse les fixer (Ménon , 97, E). Mais, malgré cette infériorité, l’opinion vraie ici encore est placée tout auprès de la science. On le voit bien par la fin du Théétète où l’opinion vraie accompagne la définition alethes doxa meta logou et est distinguée de la science. Mais il est aisé de voir par l’ensemble de la discussion qu’elle est fort au-dessus de la sensation dont il a été question antérieurement. A la fin du Philèbe (67, B), quand Platon énumère par ordre de dignité les divers éléments du Bien, il place les opinions vraies, orthai doxai, immédiatement après les sciences et sur le même rang. Nous retrouvons encore la même doctrine dans le Phèdre (205, C) et c’est même là qu’elle se retrouve avec le plus de netteté. Nous y voyons en effet les différents moyens à l’aide desquels on peut parvenir à l’opinion vraie. Tels sont l’inspiration poétique, la divination, le délire prophétique, l’amour. Il y a même des opinions vraies qui proviennent d’une origine plus basse. C’est ainsi que, dans le Timée (71, B), la large surface lisse du foie des animaux qui le fait ressembler à un miroir est considérée comme propre à représenter les images de l’avenir. Par suite, la partie inférieure du corps peut, à sa manière, participer à la vie divine et à la vérité. Enfin, dans le Ménon (97, B), Platon expose la profonde théorie de la vertu qu’il oppose à celle de Socrate , et celte théorie consiste précisément à expliquer la vertu par l’opinion vraie. Il nous est dit, en propres termes, qu’au point de vue pratique, l’opinion vraie produit les mêmes résultats que la science et n’est pas moins utile : ouden ara etton ophelimon estin orthe doxa epistemes. Et le Ménon tout entier, à le bien prendre, par sa théorie de la réminiscence autant que par celle de la vertu, est une apologie de l’opinion vraie.
Il serait aisé de multiplier les exemples et les citations. Partout on verrait que Platon, ayant conçu un idéal de science très haut et très noble, s’est rendu compte que l’esprit humain ne pouvait pas y atteindre, et qu’il doit souvent s’en tenir à cette connaissance intermédiaire, l’opinion vraie, équivalent ou succédané de la science, sorte de pis-aller dont il faut savoir se contenter. Mais encore cette connaissance intermédiaire ne doit-elle pas être méprisée. Elle est connaissance de la vérité et participe au divin, pour ainsi dire, au second degré. C’est un des traits caractéristiques de la méthode de Platon d’avoir partout multiplié les intermédiaires, les moyens termes, si bien qu’il passe d’une manière continue d’une partie à une autre et parvient à tout embrasser. Ces intermédiaires sont d’ailleurs ramenés à l’unité parce qu’ils sont tous soumis à une sorte de mathématique interne, qui, par la proportion, maintient l’unité dans la diversité. C’est ainsi que l’opinion (doxa) est à la simple conjoncture (eikasia) ce que la connaissance intuitive (noesis) est à la science discursive (dianoia) [Rép., VI, 511] et ces divisions (tmemata) dans la théorie de la connaissance correspondent exactement aux divisions de la théorie de l’être. La science est à l’opinion ce que l’être est au devenir. L’opinion vraie est la science du devenir.
Cette place faite à l’opinion vraie, au vraisemblable, dans le système de Platon était en quelque sorte exigée par l’ensemble de la doctrine. Étant donnés, d’une part, la distinction de l’être et du devenir empruntée à Parménide et à Héraclite ; d’autre part, l’idée que Platon se fait de la science, il était impossible que le devenir ou le monde de la génération fût objet de science. Par essence et par définition, en effet, il est, comme l’avait vu Héraclite, soumis au changement, et, les mots étant toujours pris chez Platon dans un sens absolu, il s’agit ici d’un changement perpétuel qui atteint toutes les parties et ne laisse subsister rien de fixe. Dès lors, de deux choses l’une : ou bien la philosophie s’en tiendra à la science pure, et alors il lui faudra renoncer à rien dire de l’homme, du monde, de l’âme, et môme, comme nous le verrons, des dieux; elle s’enfermera, comme l’Éléatisme, dans une formule vide et stérile qui n’explique rien, parce qu’elle s’applique à tout, et elle renoncera à ce qui est, en fin de compte, l’objet même de la philosophie, c’est-à-dire l’explication du monde; ou bien, à côté de la science rigoureuse, elle fera place à un mode de connaissance inférieure, participant de la nature de son objet, c’est-à-dire mobile et changeant. Entre ces deux partis le choix de Platon ne pouvait être douteux, et les mêmes raisons qui, dans sa métaphysique, l’obligent à placer le devenir à côté de l’être, le contraignent dans sa théorie de la connaissance, à placer l’opinion vraie à côté de la science. Il y a un probabilisme platonicien qui fait partie du système au même titre que la philosophie du devenir, au même titre que la théorie même de la science.
Que telle soit bien la signification du Platonisme, c’est ce que l’histoire a prouvé. Quand les successeurs de Platon abandonnèrent la théorie des Idées et de la science, il ne resta plus que le probabilisme. Ce n’est sans doute pas sans motif que des hommes comme Arcésilas et Carnéade prétendirent toujours relever de Platon et continuer sa tradition.
Si telle est la place faite à la probabilité dans le dogmatisme platonicien, le rôle du mythe s’explique tout naturellement. Le mythe est l’expression de la probabilité. Il faudrait d’ailleurs se garder de croire que le mythe soit toujours chez Platon un simple jeu de l’imagination. Personne ne contestera que le mythe de Poros et de Pénia dans le Banquet n’exprime d’une manière allégorique la doctrine développée plus loin par Socrate, et qui considère l’amour comme un démon intermédiaire entre les dieux et les hommes. Dans le Timée, Platon unit ensemble les fictions poétiques et les raisonnements mathématiques. Il rapproche ce qu’il appelle le raisonnement vrai et l’apparence, lorsque, par exemple, expliquant du point de vue de la vraisemblance la formation des éléments, il la rattache à la formation des triangles indivisibles et à toute cette géométrie singulière qui sans aucun doute se relie étroitement à ses spéculations les plus hautes. Son intention apparaît ici très clairement dans le texte même qu’il faut citer (Timée, 24, D). Il vient de distinguer avec la plus grande précision l’intelligence et l’opinion vraie, « car l’une se forme par l’enseignement, l’autre par la persuasion; l’une est toujours conforme à la droite raison, l’autre est sans raison; l’une est inébranlable dans sa conviction, l’autre est mobile dans sa persuasion. L’opinion vraie est le partage de tous les hommes; l’intelligence n’appartient qu’aux dieux et à un petit nombre d’hommes » ; et un peu plus loin, avant d’arriver à l’explication géométrique des éléments, il nous dit en propres termes qu’il rapproche l’un de l’autre le raisonnement scientifique, logos orthos, et le vraisemblable, eichos (Timée, 56, B). Et c’est visiblement sa prétention, à travers tout le Timée, de rapprocher autant que possible l’explication plausible du monde des principes de sa philosophie. C’est pourquoi il insiste à plusieurs reprises sur la théorie des Idées elle-même, et s’efforce de rattacher les causes secondaires ou adjuvantes aux causes principales, la nécessité et la matière à cette intelligence qui leur persuade de se soumettre à ses lois. C’est ainsi que dans toute l’ouvre de Platon s’unissent et se marient sans se confondre et se nuire l’une à l’autre l’explication scientifique et l’exposition mythique.
Ver online : Platon
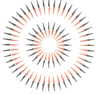 PhiloSophia
PhiloSophia
