Página inicial > Antiguidade > Brochard : LES MYTHES DANS LA PHILOSOPHIE DE PLATON
 Brochard : LES MYTHES DANS LA PHILOSOPHIE DE PLATON
Brochard : LES MYTHES DANS LA PHILOSOPHIE DE PLATON
segunda-feira 17 de junho de 2013, por
Il est certain que Platon blâme souvent l’interprétation des poètes telle qu’elle était pratiquée par les sophistes et qu’il se montre fort sévère pour certaines fictions poétiques. Mais, d’un autre côté, comment comprendre que lui-même se soit si souvent abandonné à sa fantaisie et qu’il ait introduit tant de fictions et de poésie dans son ouvre. Un philosophe ennemi absolu des mythes ne fait pas tant de mythes. Enfin, en lisant les mythes les plus considérables, notamment ceux du Gorgias, du Phédon , de la République, qui ont trait à la vie future, on a le sentiment très net qu’il ne s’agit pas là pour Platon d’un simple amusement. Il est impossible de n’être pas frappé du ton grave et presque religieux qu’il prend naturellement quand il s’explique sur ces grands sujets. Sans doute sa pensée est un peu incertaine et flottante, et il est facile de signaler, d’un dialogue à l’autre, de nombreuses et importantes différences de détail. Mais il semble aussi impossible de contester qu’ils ont tous une même tendance et qu’ils expriment tous une même pensée fondamentale, que Platon a pu sans doute présenter sous les formes les plus variées, mais qui, pour ce qu’elle a d’essentiel, n’a pas changé et lui tient fort à cour.
C’est surtout à propos du Timée que se pose la question de la valeur du mythe chez Platon. Ce dialogue, en effet, paraît mythique du commencement à la fin, et, en un sens, il est impossible de contester qu’il le soit. Platon lui-même, à chaque instant et avec un parti pris évident, nous avertit qu’il parle selon la vraisemblance et qu’il n’a pas la prétention de nous révéler la vérité absolue et définitive. Si pourtant ce dialogue ne contenait pas une partie importante des doctrines de Platon, et s’il ne se rattachait pas étroitement à sa philosophie, comment comprendre que le philosophe ait écrit par amusement un travail de cette étendue. Le badinage serait un peu long. Il est aisé de voir d’ailleurs que, dans ce dialogue écrit vraisemblablement dans sa vieillesse, Platon a consigné les résultats de très longues et très nombreuses recherches. Ce n’est visiblement pas l’ouvre d’un jour, mais au contraire le résultat de patientes études. L’auteur nous le dit lui-même. A plusieurs reprises il parle avec fierté de son ouvre et se vante d’être le premier qui ait écrit sur la nature un ouvrage d’une telle importance, et en quelques endroits, notamment 51, D, et dans toute la discussion qui suit, il semble mettre les philosophes au défi de trouver des explications plus plausibles que la sienne. Et on ne peut pas dire qu’il ait tort, car il est bien évident que, malgré ses imperfections et les nombreuses erreurs qu’y peut relever la science moderne, le Timée marque un progrès notable sur tous les traités antérieurs de la « Nature ». C’est une ouvre, dans la pensée de l’auteur, non de fantaisie, mais de science. C’est bien ainsi que l’entend Aristote, qui le discute fort sérieusement; et, dans la suite, le Timée est resté un des ouvrages qui ont exercé le plus d’influence sur les destinées de l’esprit humain : il a été considéré jusqu’ au moyen âge comme le bréviaire de la science physique.
Tout porte donc à croire que, dans la pensée de son auteur, le Timée n’est pas un simple amusement et qu’il doit y avoir un lien étroit entre la physique qu’il expose et la théorie des Idées. Il nous semble que ce lien existe et que même il n’est pas difficile de le montrer.
Ver online : Platon
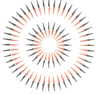 PhiloSophia
PhiloSophia
