Página inicial > Modernidade > Lavelle: Introduction à la dialectique de l’éternel présent (III)
 Lavelle: Introduction à la dialectique de l’éternel présent (III)
Lavelle: Introduction à la dialectique de l’éternel présent (III)
quarta-feira 23 de março de 2022, por
Introduction à la dialectique de l’éternel présent (III)
Si l’expérience initiale est l’expérience de la participation par laquelle le moi constitue l’existence qui lui est propre, on comprend sans peine qu’elle s’oriente en deux sens différents ou qu’elle comporte deux extrémités entre lesquelles elle ne cesse d’osciller et dont aucune ne peut être considérée isolément. L’une est celle de l’acte pur, ou de l’acte qui n’est qu’acte (et que l’on retrouve sous une forme moins dépouillée dans les expressions de puissance créatrice ou même d’élan vital et d’énergie cosmique, mais à laquelle il faut maintenir une intériorité spirituelle absolue pour la mettre au-dessus de toute limitation et par conséquent de toute passivité et de toute donnée) et l’autre est formée par le monde, où l’infinité de l’acte accuse encore sa présence par cette infinité de choses et d’états qui semblent naître de la participation elle-même et qui traduisent indivisiblement à la fois en nous et hors de nous ce qui la dépasse et ce qui lui répond [Cette analyse montre assez nettement pourquoi l’intelligible et le sensible doivent toujours à la fois s’opposer et se correspondre, sans que le premier absorbe jamais l’autre. C’est de cette opposition et de cette correspondance que nous avions essayé de donner un premier exemple dans notre Dialectique du monde sensible (1923).].
Nous dirons du monde qu’il remplit l’intervalle qui sépare l’acte pur de l’acte de participation. C’est pour cela que ce monde est un monde donné, mais c’est pour cela aussi que sa richesse est inépuisable. Et loin de penser qu’à mesure que l’activité intérieure se développe davantage, elle fait reculer la représentation que nous avons de l’univers extérieur et tend à la dissoudre, il faut dire au contraire que le propre de cette activité intérieure, c’est de multiplier à l’infini les distinctions qualitatives que nous pouvons établir entre les choses, de telle sorte que le monde, qui apparaît comme une masse confuse à la conscience naissante, découvre à une conscience plus délicate et plus complexe une variété d’aspects de plus en plus grande. Il est vrai que tous ces aspects du donné, l’intelligence, à mesure qu’elle croît, tentera de les couvrir d’un réseau de plus en plus serré de relations conceptuelles, que l’art cherchera en eux l’expression des exigences les plus raffinées de la sensibilité, que la volonté en fera le véhicule de plus en plus docile de tous les actes par lesquels elle cherchera à obtenir une communion avec les autres volontés.
Cependant la question est d’abord de savoir comment s’exerce cette liberté par laquelle le moi pose son existence propre comme une existence dont il est l’auteur. Or, si toutes les libertés puisent dans le même acte dont elles participent l’initiative même qui les fait être, il faut à la fois qu’elles lui demeurent unies et qu’elles s’en détachent, c’est-à-dire que leur coïncidence actuelle avec l’être ne cesse jamais de s’affirmer et qu’elles puissent constituer pourtant en lui un être qu’elles ne cessent elles-mêmes de se donner. Cette double condition se trouve réalisée précisément à l’intérieur du présent, qui est une présence totale, c’est-à-dire la présence même de l’être, et qui est telle que nous pouvons distinguer en elle des modes différents et, par les relations que nous établirons entre eux, constituer précisément l’être qui nous est propre. Mais cette relation entre les différents modes de la présence, c’est le temps, où nous distinguons d’abord une présence possible ou imaginée, c’est-à-dire que nous n’avons pas encore faite nôtre, mais qui le deviendra par une action qu’il dépend de nous d’accomplir (cette présence, c’est l’avenir); qui est appelée elle-même à se convertir en une présence actuelle ou donnée dans laquelle notre existence et notre responsabilité se trouvent engagées à l’égard de l’ensemble du monde (c’est la présence dans l’instant); qui se convertit à son tour en une présence remémorée ou spirituelle (c’est la présence du passé) qui constitue notre secret, qui n’a de sens que pour nous, et qui est proprement tout ce que nous sommes.
La liaison de l’avenir et du possible justifie le caractère indéterminé à la fois de l’un et de l’autre : mais il n’y a de possibilité qu’à partir de la participation, soit que nous considérions celle-ci comme une analyse de l’être imparticipé, et plus précisément comme un acte de pensée destiné à anticiper un acte du vouloir, soit que nous considérions dans chaque possible l’accord dont il doit témoigner à la fois avec les autres possibles et avec leurs formes déjà réalisées, afin que l’unité de l’être ne soit pas rompue. — La liaison de l’existence avec le présent accuse d’une part l’impossibilité de ne point considérer comme actuel tout acte s’accomplis-sant soit dans sa forme pure, soit dans sa forme participée, et d’autre part la nécessité d’introduire notre moi lui-même dans un monde donné, où s’exprime sa solidarité avec tous les autres modes de l’existence en tant que nous leur imposons notre action ou que nous subissons la leur. — La liaison de notre être réalisé avec le passé montre assez comment il se libère alors à la fois de son indétermination, qui ne cessait de l’affecter aussi longtemps qu’il n’était qu’un être possible et de la servitude à laquelle il était réduit aussi longtemps qu’il était engagé dans le monde des corps : c’est notre passé qui pèse sur nous comme poids étranger; mais notre passé présent exprime le choix vivant que nous avons fait de nous-mêmes; il est cet être spirituel et invisible où notre liberté ne cesse à la fois de s’éprouver et de se nourrir. Notre incidence avec le monde nous avait permis d’entrer en communication avec tout ce qui est et qui nous dépasse; tous ces contacts ont été spiritualisés; il ne subsiste plus d’eux maintenant que leur essence significative et désincarnée.
Cette théorie du temps défini comme le moyen même de la participation est destinée à préparer une théorie de l’âme humaine. Car l’âme n’est point une chose, mais une possibilité qui se choisit et qui se réalise. D’une manière plus précise, elle est le rapport qui s’établit dans le temps entre notre être possible et notre être accompli. Elle est une conscience, mais dans laquelle on ne trouve jamais rien de plus que la pensée du passé et de l’avenir dont il faut dire qu’ils ne trouvent qu’en elle leur subsistance. Et comme en témoigne l’introspection dès que nous l’interrogeons, la conscience est un mouvement continu et réciproque entre la pensée de ce qui n’est plus et la pensée de ce qui n’est pas encore : elle ne cesse de passer de l’un à l’autre et de les convertir l’un dans l’autre. Dans le présent instantané elle ne trouve pas autre chose qu’une réalité donnée, c’est-à-dire le monde ou la mati ère. Elle se constitue en s’en détachant. Mais c’est dans l’instant aussi qu’elle exerce son acte propre, qui est un acte de liberté, et cet acte ne peut s’accomplir qu’en s’arrachant à la présence donnée afin de créer le temps, c’est-à-dire le rapport de l’avenir et du passé; le temps est donc le véhicule même de la liberté. Seulement la conversion de l’avenir en passé exige une traversée de la présence donnée où notre conscience témoigne de sa limitation et par conséquent de sa solidarité avec toutes les autres consciences; c’est ici que l’âme fait l’expérience de sa relation avec le corps et avec le monde dont on voit assez bien le rôle, qui est de fournir aux différentes consciences les instruments qui les séparent et aussi qui les unissent. Or, le possible, et le souvenir ne peuvent pas appartenir à l’esprit pur : ils ne rompent jamais tout rapport avec le corps dont on peut dire que sans lui l’un ne pourrait pas être appelé, ni l’autre rappelé; le corps les distingue et les joint; il dissocie le temps de l’éternité, mais l’y situe.
Une telle analyse permet d’établir un tableau systématique des différentes puissances du moi; il faut en effet qu’il puisse se constituer lui-même dans le temps grâce à une double puissance volitive et mnémonique qui, en s’exerçant, forme tout le contenu de notre vie intérieure; qu’il puisse atteindre par une double puissance représentative et noétique, c’est-à-dire sous la forme d’un objet qui est donné et d’un concept qui est pensé, cela même qui le dépasse et qui n’est qu’un non-moi en rapport avec moi; il faut enfin qu’une communication puisse s’établir entre moi et l’autre que moi, grâce à une puissance affective inséparable elle-même d’une puissance expressive. Et peut-être faut-il reconnaître que la distinction d’un triple, domaine, celui de la formation du moi, de l’exploration du non-moi et de la découverte d’un autre moi, avec la corrélation, dans chacun de ces domaines, d’une action qu’il faut accomplir et d’une donnée, qui lui répond, suffit à déterminer d’une manière, assez satisfaisante les repères fondamentaux par lesquels on peut mesurer le champ de la conscience et décrire le jeu infiniment varié de ses opérations et de ses états.
On montrera enfin que, si le propre de la sagesse, c’est de chercher à obtenir cette maîtrise de soi qui nous empêche de nous laisser jamais troubler, ni accabler par l’événement, celle-ci ne peut être obtenue par une tension de notre activité séparée, qui, pour marquer que nous sommes capables de nous suffire, accuse notre conflit avec l’univers et cache mal une défaite continue en cherchant à la transformer en une apparente victoire. C’est seulement dans la mesure où notre activité se reconnaît elle-même comme une activité de participation — toujours sollicitée par une présence qui ne lui manque jamais et qui demande d’elle un consentement qu’elle donne seulement quelquefois et qu’elle marchande toujours — qu’elle sera capable de surmonter cette triple dualité entre ce qu’elle désire et ce qu’elle a, entre son effort et la résistance que le monde lui oppose, entre le moi qu’elle assume et le moi d’autrui, d’où dérivent tous les malheurs inséparables de la condition même de la conscience. La sagesse n’est pas de les approfondir, mais de les apaiser.
Elle n’y parvient nullement par l’emploi des deux moyens qui lui sont souvent proposés tantôt séparément et tantôt simultanément : à savoir en premier lieu par une résignation indifférente, à l’égard de la réalité telle qu’elle nous est donnée et que l’on nous demande de considérer comme nous étant étrangère; car cette réalité donnée est mêlée à notre vie comme la matière et l’effet de notre action, de telle sorte qu’une parfaite indifférence à son égard n’est ni possible ni désirable; en second lieu par une sorte d’abdication de notre activité propre en faveur d’une activité qui agirait en nous sans nous et par laquelle il suffirait de se laisser porter, comme on le voit dans le quiétisme et dans certaines formes de l’abandon; mais si le sommet de la participation est aussi le sommet de la liberté, il ne faut pas qu’en poussant la première jusqu’à la limite, on accepte de ruiner l’autre.
C’est que la sagesse n’est donc rien de plus que la discipline de la participation, c’est-à-dire une certaine proportionnalité que nous savons établir entre nos actes et nos états, où la dualité de la nature humaine se trouve respectée, mais où, au lieu de permettre que nos actes soient déterminés par nos états, nos états dessinent si exactement la forme de nos actes qu’ils paraissent les exprimer et les suivre et qu’ils s’en distinguent à peine. Les Anciens avaient toujours lié le bonheur à la sagesse, comme si la sagesse résidait dans une certaine disposition de l’activité dont le bonheur fût le reflet ou l’effet dans notre vie affective. Et il y avait pour eux une union si étroite entre les deux termes qu’aucun des deux ne pouvait exister sans l’autre, comme s’ils étaient les deux faces d’une même réalité : tel est le point sans doute où la participation reçoit sa forme la plus parfaite. Et on peut bien aujourd’hui la considérer comme impossible à atteindre. Mais ce serait un mauvais signe si on la méprisait et si la conscience s’épuisait dans la recherche d’états plus violents et finissait par se complaire dans sa propre impuissance et son propre tourment. Car où la conscience croit s’aiguiser davantage, elle est la proie des forces qu’elle ne domine plus : la lumière lui est ôtée. On rabaisse vainement comme trop facile ce qui ne peut être obtenu que par une force que l’on a perdue.
Ver online : Louis Lavelle
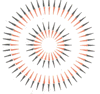 PhiloSophia
PhiloSophia